COP30 : Le climat ne se négocie pas, il se vit !
À Belem, la COP30 ne peut plus se contenter de bilans. Elle doit écouter ce que les corps savent sur le terrain. Les corps qui soignent, qui cultivent, qui fuient, qui résistent. Derrière les chiffres et les seuils, il y a des vies qui portent la mémoire des dérèglements climatiques. Et dans cette mémoire, une autre écologie plus juste et contextualisée se dessine. Analyse.
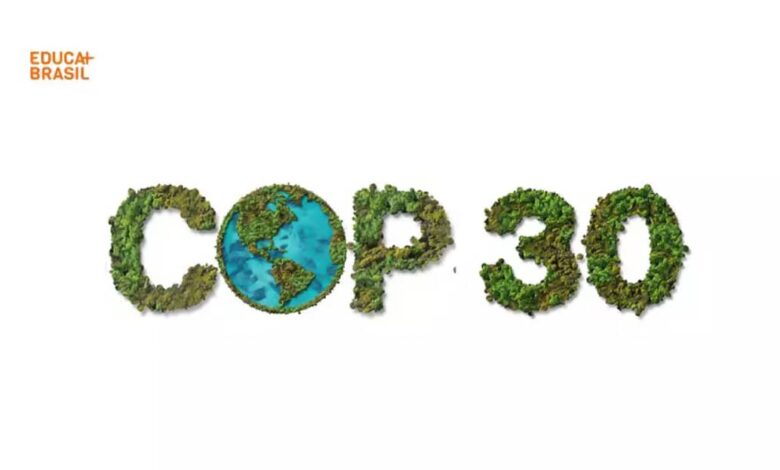
La scène internationale s’est habituée à parler du climat comme d’un enjeu global, abstrait, technique. On y évoque des tonnes de CO₂, des trajectoires de décarbonation, des mécanismes de compensation. Mais dans les villages, les quartiers, les hôpitaux, les marchés, le climat ne se négocie pas. Il se vit. Il se traverse. Il s’inscrit dans les corps.
À Belem, la COP30 s’ouvre dans un monde où les seuils sont déjà franchis pour beaucoup. Les sécheresses ne sont plus des anomalies, elles sont des rythmes. Les inondations ne sont plus des urgences, elles sont des habitudes. Et dans cette répétition, ce sont les femmes, les enfants, les soignantes, les paysans, les déplacés qui portent le poids du dérèglement.
Ce texte ne propose pas une énième analyse technique. Il part des corps. Des corps qui savent. Qui savent ce que c’est que de manquer d’eau, de perdre une récolte, de fuir un village, de réorganiser les soins, d’improviser des solidarités. Ces corps sont les premiers capteurs du climat. Et pourtant, ils sont les derniers à être écoutés.
Les corps qui soignent et qui tiennent
Dans les zones rurales du Sahel, les femmes réorganisent les cycles de soin à chaque saison. Elles adaptent les plantes médicinales aux nouvelles températures, elles réinventent les solidarités quand les dispensaires sont inaccessibles. Elles ne parlent pas de résilience, elles la vivent.
Dans les quartiers informels de Kinshasa ou de Douala, les jeunes femmes réorganisent les circuits alimentaires, les espaces de repos, les lieux de sécurité. Elles ne demandent pas des financements, elles demandent qu’on reconnaisse leur rôle dans la survie collective.
Ces corps qui soignent sont aussi ceux qui tiennent. Qui tiennent les familles, les communautés, les mémoires. Et pourtant, dans les négociations climatiques, ils sont absents. On parle de « communautés vulnérables », jamais de « corps stratèges ». On parle de « besoins spécifiques », jamais de « savoirs situés ».
À Belem, il est temps de changer de grammaire. De ne plus parler pour ces corps, mais à partir d’eux. Car ils ne sont pas les bénéficiaires des politiques climatiques. Ils en sont les fondements.
Savoirs effacés, écologies incarnées
Les COP ont souvent été des scènes d’expertise. On y valorise les modèles, les projections, les indicateurs. Mais les savoirs qui viennent des corps — ceux qui cultivent, qui soignent, qui migrent — sont considérés comme anecdotiques, folkloriques, secondaires.
Or, ce sont ces savoirs qui permettent de tenir. De réorganiser les cycles agricoles, d’anticiper les maladies, de créer des refuges. Ce sont des savoirs qui ne s’écrivent pas dans les rapports, mais dans les gestes, les récits, les silences.
À Belem, il faut renverser les hiérarchies. Reconnaître que les écologies incarnées — celles qui partent des corps, des mémoires, des pratiques — sont plus précises, plus stratégiques, plus durables que les modèles importés.
Cela implique de changer les formats. De ne plus imposer des projets, mais de co-construire des démarches. De ne plus chercher à « intégrer » les femmes, mais de partir de leurs logiques. De ne plus parler de « bénéficiaires », mais de partenaires épistémiques.
Financer sans dominer
Les mécanismes de financement climatique sont souvent présentés comme des solutions. Mais ils perpétuent des logiques de dépendance. Ils conditionnent l’accès aux ressources à des critères extérieurs, à des temporalités imposées, à des langages techniques.
Or, les communautés africaines ne demandent pas des aides. Elles demandent des espaces de souveraineté. Des espaces où elles peuvent décider, adapter, transmettre. Des espaces où les ressources ne sont pas des récompenses, mais des reconnaissances.
À Belem, il faut repenser la diplomatie climatique. Non pas comme une négociation entre États, mais comme une articulation entre mémoires, savoirs et dignités. Il faut sortir du paradigme de la dette — dette carbone, dette financière — pour entrer dans celui de la responsabilité partagée.
Cela implique de reconnaître les réparations. Non pas comme des gestes symboliques, mais comme des engagements concrets : redistribution des ressources, protection des savoirs, reconnaissance des droits territoriaux, valorisation des récits.
Pour une diplomatie des corps
La COP30 ne peut être une répétition. Elle doit être une bifurcation. Et cette bifurcation ne viendra pas des chiffres, mais des corps. Des corps qui savent, qui portent, qui proposent.
Il est temps de penser une diplomatie des corps. Une diplomatie qui ne s’écrit pas seulement dans les couloirs des négociations, mais dans les villages déplacés, les dispensaires surchargés, les terres épuisées. Une diplomatie qui écoute les récits, respecte les rythmes, valorise les savoirs situés. Une diplomatie qui ne cherche pas à convaincre, mais à relier.
Dans cette diplomatie, l’Afrique ne vient pas demander. Elle vient proposer. Proposer une écologie de la dignité. Une écologie qui ne se mesure pas en tonnes de carbone, mais en vies préservées, en mémoires honorées, en solidarités renforcées.
Baltazar ATANGANA
Expert en genre et développement
noahatango@yahoo.ca





