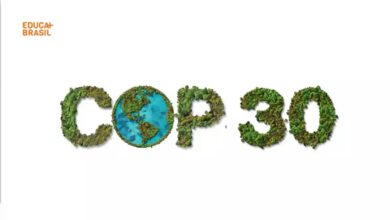Politiques climatiques africaines : Quand le silence sur les violences genrées freine la résilience
Les États africains multiplient les engagements climatiques, traduisant une volonté affirmée de résilience et de durabilité. Pourtant, une dimension essentielle reste largement absente des stratégies nationales : les violences basées sur le genre (VBG). Les crises environnementales, loin d’être neutres, exacerbent les inégalités et redéfinissent les vulnérabilités, affectant de manière différenciée les corps, les droits et les trajectoires, notamment des femmes et des jeunes filles. Dans cette brève analyse, Baltazar ATANGANA, expert en genre, interroge la capacité des politiques climatiques africaines à intégrer les violences genrées comme enjeu structurel, révélateur de la qualité démocratique et de l’inclusivité des réponses environnementales.

Une vulnérabilité genrée ignorée dans les stratégies climatiques
Les plans nationaux d’adaptation (PNA) et les contributions déterminées au niveau national (CDN) élaborés par les États africains affichent des ambitions en matière de résilience climatique. Toutefois, une analyse croisée des documents stratégiques du Sénégal, du Kenya et du Cameroun révèle une absence quasi systématique de dispositifs de prévention des VBG. Le genre y est souvent mentionné comme une variable sociale, rarement comme une dimension politique liée aux rapports de pouvoir et à la sécurité des femmes.
Au Sénégal, bien que la mobilisation de la société civile contre les violences faites aux femmes se renforce, les politiques climatiques nationales continuent d’ignorer les risques accrus de violences en contexte de crise environnementale. En mai 2025, le Cadre de concertation citoyen pour le respect et la préservation des droits des femmes et des filles a lancé un manifeste appelant à une participation effective des femmes dans les instances de gouvernance, ainsi qu’à leur prise en compte dans l’élaboration des politiques publiques. Cette initiative, portée notamment par des militantes comme Arame Gueye, réclame une représentation accrue des femmes au sein du gouvernement. De tels mouvements méritent non seulement d’être soutenus, mais aussi d’être visibilisés à l’échelle continentale, tant ils incarnent une dynamique de transformation sociale. Par ailleurs, la Fondation Heinrich Böll souligne que dans les zones rurales sénégalaises touchées par la sécheresse, les violences sexuelles et les mariages précoces sont en nette augmentation, sans que les plans d’adaptation climatique ne proposent de réponses spécifiques à ces enjeux pourtant cruciaux.
Au Kenya, la situation est alarmante : plus de 7 100 cas de violences basées sur le genre ont été enregistrés entre septembre 2023 et décembre 2024, dont 100 féminicides documentés. Pourtant, les CDN du pays ne comportent aucune mesure concrète de protection des femmes dans les zones climatiquement vulnérables. Il est important de noter que moins d’un tiers des pays africains intègrent des mécanismes de prévention des VBG dans leurs stratégies climatiques.
Au Cameroun, la prévalence des violences physiques et sexuelles demeure préoccupante, notamment dans les régions affectées par les conflits liés à l’accès aux ressources naturelles. Cette réalité s’inscrit dans un contexte de vulnérabilité climatique croissante, où les crises environnementales exacerbent les inégalités sociales et les risques de violence. En 2024, au moins 77 féminicides ont été recensés dans le pays, selon les associations féministes mobilisées pour faire adopter une loi spécifique contre les violences basées sur le genre. Pourtant, les politiques environnementales nationales continuent d’ignorer les liens structurels entre changement climatique et violences genrées. Cette omission persiste malgré les efforts d’acteurs locaux tels que l’association Parler d’Elles, qui a salué l’adoption récente d’un projet de loi visant à renforcer la lutte contre les violences faites aux femmes et à améliorer l’accès à l’éducation des jeunes filles. Si ces initiatives traduisent une volonté politique émergente, elles demeurent encore trop déconnectées des enjeux climatiques, alors même que les aléas environnementaux aggravent les vulnérabilités genrées. Une articulation plus étroite entre politiques climatiques et dispositifs de protection des femmes apparaît dès lors comme une exigence stratégique pour une gouvernance véritablement inclusive et durable.
Une gouvernance climatique encore plus sensible au genre
L’absence de données désagrégées dans les politiques climatiques africaines constitue une entrave majeure à la formulation de réponses efficaces. Plus de 60 % des femmes victimes de violences ne les signalent pas, en raison de la peur, de la stigmatisation ou du manque de confiance dans les institutions. Ce silence statistique est une forme de violence épistémique, qui invisibilise les expériences féminines dans les dispositifs de gouvernance climatique.
Pour construire une résilience inclusive, il est impératif d’intégrer les violences genrées dans les indicateurs de vulnérabilité climatique. Cela implique de produire des données fiables, de financer les mécanismes de protection, de former les acteurs climatiques aux enjeux de genre, et de reconnaître les femmes comme actrices de résilience. Les savoirs situés, les pratiques communautaires et les formes de leadership féminins doivent être valorisés dans les processus de planification et de mise en œuvre.
Une gouvernance climatique encore plus sensible au genre ne se limite pas à l’ajout d’une ligne « femmes » dans les budgets. Elle suppose une transformation des paradigmes : reconnaître que les violences ne sont pas des externalités, mais des révélateurs de la qualité démocratique des politiques publiques. C’est à cette condition que les stratégies climatiques africaines pourront répondre aux défis du siècle sans reproduire les inégalités du passé.
Sans justice de genre, pas d’Objectifs de développement durable
L’absence de prise en compte des violences basées sur le genre dans les politiques climatiques africaines ne constitue pas seulement une lacune technique : elle compromet directement la réalisation des Objectifs de développement durable (ODD). Le rapport de l’UICN, intitulé Liens entre la violence basée sur le genre et l’environnement (UICN, 2020), démontre que les VBG entravent la mise en œuvre des ODD liés à la santé, à l’égalité, à la paix, à la justice et à la durabilité environnementale. En ignorant cette intersection, les États africains fragilisent leurs propres engagements internationaux.
Une gouvernance climatique véritablement transformatrice ne peut faire l’économie d’une lecture genrée des vulnérabilités. Elle doit reconnaître que les violences ne sont pas des externalités sociales, mais des indicateurs de la qualité démocratique des politiques publiques. Intégrer les VBG dans les stratégies climatiques, c’est renforcer la résilience collective, crédibiliser les engagements environnementaux et inscrire l’action publique dans une logique de justice. C’est aussi, fondamentalement, refuser que la transition écologique se fasse au prix du silence sur les corps féminins.
Baltazar ATANGANA
noahatango@yahoo.ca