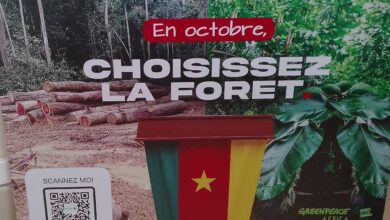Côte d’Ivoire : Journalistes et scientifiques explorent de nouvelles pistes de collaboration
Du 9 au 14 juin 2025, la ville d’Abidjan, en Côte d’Ivoire, a accueilli la 2ᵉ édition de la Conférence mondiale des journalistes scientifiques francophones (CMJSF 25). Au-delà des échanges autour du thème principal : « One health » (« Une seule santé » en français), cette rencontre a été pour ces partenaires, tous liés par le souci commun du bien-être des populations (les uns à travers la recherche, les autres par l’information), l’occasion de lever un pan du voile sur leurs différends. Comme le concept « One health », qui englobe toutes les sphères de la santé (animale, environnementale et humaine), journalistes et scientifiques ont mutuellement besoin les uns des autres pour accomplir leurs missions. Cette reconnaissance, on l’espère, augure des lendemains meilleurs pour la promotion de l’information scientifique en Afrique et dans le monde.

Entre ressentiment et incompréhension
C’est une relation empreinte de suspicion, de crainte voire d’inimitié qui uni parfois journalistes et chercheurs notamment en Afrique. « De tout mon parcours de médecin, je n’ai jamais vu de journaliste scientifique qui vienne me poser la question : « Docteur, qu’est-ce que vous vivez ici, de quoi avez-vous besoin ou même parler aux malades pour recueillir leur ressenti, leurs suggestions pour améliorer le système », se plaint Mouhamed Amoussa, médecin-chercheur, après avoir peint les conditions précaires des formations sanitaires en Afrique. « Pour moi, les journalistes sont là pour partager l’information, faire en sorte que ce qui se passe quelque part, soit relayé dans le monde entier. Il ne faut pas attendre qu’il y ait une crise sanitaire pour courir. Mais pendant que le système se dégrade, on ne les voit pas du tout », ajoute-t-il au cours d’un panel de la 2e Conférence mondiale des journalistes scientifiques francophones (CMJSF 25) qui s’est tenue en Côte d’Ivoire du 9 au 14 juin 2025 sous le thème : « One health ». Modérée par Fulbert Rodrigue Adjimèhossou, journaliste scientifique, ce panel interroge le « rôle des journalistes dans un monde en crise : comment traiter l’environnement et la santé dans les médias ».
La session accueille également comme intervenants : Victoire N’Sondé, Cheffe de rubrique Santé à The Conversation en France ; Magali Reinert, Auteure de Changement climatique, quels défis pour le Sud ? ; Hector Nammangue, fondateur du webmagazine Vert-Togo. Mouhamed Amoussa plaide pour une couverture médiatique « plus humaine » des sujets scientifiques. « Que les journalistes scientifiques viennent avec empathie sans caméra ni micro pour discuter. Je ne demande pas qu’ils deviennent des médecins ou des chercheurs, mais juste des êtres humains pour comprendre et utiliser la meilleure formulation pour que cela puisse faire effet ». Dans un autre panel, des chercheurs racontent des expériences « désastreuses » avec des journalistes, accusés de tordre ou sortir leurs propos de leur contexte. Du côté des journalistes, l’on déplore l’accès difficile aux sources d’information que sont les scientifiques entre autres griefs.

Des attentes non comblées
« Tous les collègues ici ont déjà eu ce problème. On vous a commandé un article scientifique et le chercheur que vous appelez ne répond pas. J’ai moi-même connu cela. J’ai contacté un chercheur qui m’a fait poireauter pendant cinq mois. En fait, il ne m’a jamais répondu », témoigne Kossi Balao, président du Réseau des journalistes scientifiques de l’Afrique francophone (RJSAF). Mamadou Traoré, président de Médias pour la science et le développement (MDS), l’association des journalistes scientifiques de la Côte d’Ivoire, relate-lui aussi, une expérience similaire. « La vulgarisation scientifique repose-t-elle sur le journaliste ou sur le chercheur ? Pourquoi c’est si difficile de nous entendre ? », interroge Kossi Balao, posant le diagnostic de la relation étriquée entre journalistes et scientifiques. L’objectif du panel qu’il modère en plein milieu du Parc national du Banco est d’élaborer des pistes de collaboration entre journalistes, communicants et chercheurs.
Un « ménage à trois » qu’il faut gérer en tenant compte des intérêts des uns et des autres. « Les chercheurs ont besoin de nous pour parler de leurs travaux. Et nous avons besoin d’eux pour nourrir le débat public », soutient Magali Reinert. « Le journaliste représente un pouvoir… Le chercheur est gouverné par le politique », justifie Pr Mathurin Koffi, généticien, président du Réseau sciences et santé unique en Côte d’Ivoire (Ressuci). A son avis, plusieurs paramètres expliquent le silence des chercheurs. D’abord, « Quand l’information donnée aux journalistes est travestie. [Ensuite], Le chercheur peut se faire taper dessus parce que le politicien n’aurait pas souhaité que l’information qu’il donne soit divulguée. Dans un certain sens, si l’information portée au grand public peut porter atteinte à sa notoriété, le chercheur va se rétracter », explique le Maître de conférences en Agroforesterie et développement.
En réalité laisse-t-il entendre, le chercheur n’a pas besoin des journalistes pour évoluer dans sa carrière. Ils ont pour cela des publications dans des revues scientifiques. « Mais la presse scientifique est importante (…) elle va au contact de la population », reconnait l’universitaire. Pour une collaboration plus saine, il propose le dialogue. « Chacun se trouve dans sa tour de confort. Il n’y a que par les échanges qu’on peut aplanir les difficultés. Les difficultés que les journalistes rencontrent vis-à-vis des chercheurs est une question d’incompréhension. Les journalistes doivent aller vers les chercheurs pour leur expliquer le bien-fondé de leurs travaux. », recommande-t-il, promettant de se faire l’écho de l’importance du journalisme scientifique auprès de ses pairs. Emmanuel Dabo, Expert en communication scientifique propose alors de se tourner vers les agences de communication spécialisée pour éviter les écueils décriés.
Une communauté en fin de compte

Lorsqu’elle est possible, la collaboration entre chercheurs et journalistes produit de bons résultats témoigne Dr Annick Coulibaly. La chercheure rapporte qu’il y a quelques années, l’association des femmes chercheurs a reçu une aide précieuse des journalistes dans la sensibilisation des jeunes filles à s’intéresser à la recherche. « Ces journalistes ont permis à de jeunes filles d’exprimer leurs difficultés, leurs freins, leurs mécontentements par rapport au système éducatif qui quelquefois ne les aidait pas à prendre des branches scientifiques ». Dans ce cas, les journalistes ont permis de mieux vulgariser la notion du genre ; favoriser la participation inclusive. « Quand il me sollicite, c’est une joie », confesse cette chercheure. Pour elle, « les journalistes ont une place dans la science. Il faut les intégrer afin qu’ils soient notre relais auprès de la population pour dire ce qu’on a trouvé et comment la population peut intégrer ces résultats pour de meilleures conditions de vie. En Afrique où la science n’a pas toujours sa place, le journaliste scientifique vient nous donner de l’aide, de l’énergie. Le journaliste scientifique est extrêmement important. Il doit faire partie des politiques de vulgarisation ».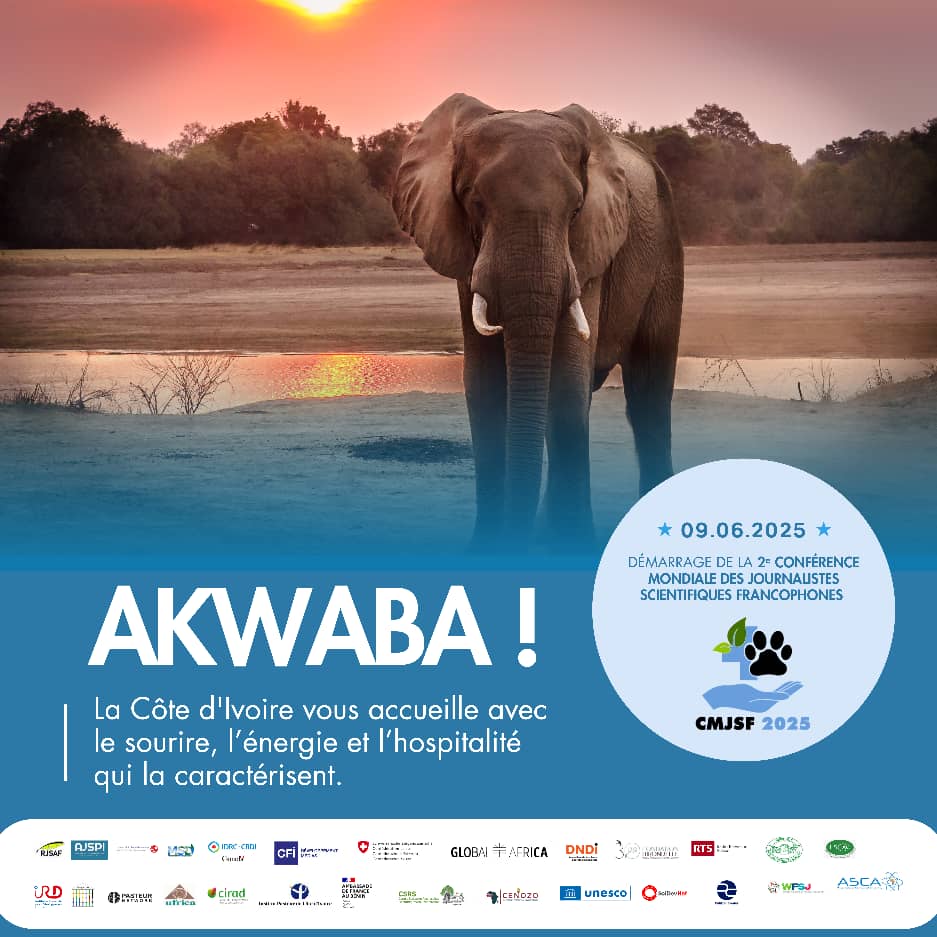
A ses pairs, Annick Koulibaly rappelle que la recherche n’est pas faite pour les tiroirs. « Il faut renforcer les capacités des chercheurs afin que les résultats de leur recherche soit exploitable. Il faut faire en sorte que les journalistes aient accès au milieu scientifique et à ces résultats qui changent la vie. Que la collaboration soit suffisamment étroite pour que journalistes et scientifiques se comprennent et parlent d’un même langage pour un avenir meilleur », recommande-t-elle comme pistes de sortie de crise. Comme le « One Health », cette santé globale qui se veut intégrative, inclusive de toutes les santés (humaine, animale, plantes et environnement), la relation entre chercheurs et journalistes ; puis les chercheurs entre eux, doit être décloisonner. Chacun devra descendre de son piédestal pour comprendre l’autre et travailler à une santé unique.
« L’homme est au centre de toutes les santés. Il n’en demeure pas moins que pour une santé durable, l’homme pense à la santé des plantes, des animaux et à la santé de son environnement. Auquel cas, nous ne pourrons pas aller vers la durabilité. Le monde que nous avons aujourd’hui est aussi celui de nos descendants. Pour construire cette durabilité, il faut que tout le monde se mette ensemble », préconise Dr Mathurin Koffi. C’est tout le sens de la CMJSF 2025 riche en enseignement grâce aux différentes formations offertes, en informations collectées pendant les tables rondes et visites des laboratoires du Centre Suisse de Recherches Scientifiques, etc. Officiellement ouvert le mardi 10 juin 2025 à l’Université Félix Houphouët-Boigny, l’évènement a rassemblé plus de 100 journalistes et spécialistes de l’Afrique, de l’Europe et de l’Amérique pour débattre des enjeux du journalisme scientifique francophone.
Nadège Christelle BOWA
De retour d’Abidjan