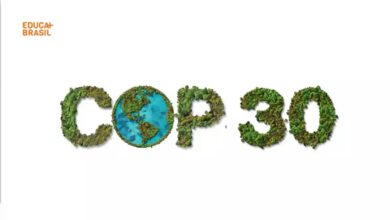Des lacunes dans les mesures d’atténuation terrestres compromettent 25 % des réductions d’émissions mondiales
Selon une nouvelle étude publiée le mercredi 30 juillet 2025 dans la revue Nature Communications Earth & Environment, 25% des réductions d'émissions promises par les pays reposent sur des mesures d'atténuation terrestres. Cependant, sans un soutien financier et institutionnel, ces réductions sont compromises.

La capacité des pays en développement tels que la RDC, l’Indonésie et l’Éthiopie à respecter les engagements terrestres pris dans leurs plans climatiques (contributions déterminées au niveau national, ou CDN) dépend du soutien financier et institutionnel qui leur est apporté, lequel fait actuellement défaut. La recherche souligne à quel point l’ampleur de la réduction des émissions de carbone liées aux terres est invisible dans le premier bilan mondial (GST) de 2023, qui s’est achevé à la fin des négociations climatiques de l’ONU à Dubaï. Cette nouvelle recherche contribue à combler ce manque d’informations en analysant systématiquement, pour la première fois, la manière dont les terres ont été prises en compte dans la dernière série de CDN (CDN 2020), qui détaillent les réductions d’émissions prévues jusqu’en 2030. La principale raison de cette lacune du GST est une disparité conceptuelle entre la manière dont les pays déclarent les gaz à effet de serre liés à l’utilisation des terres et la manière dont les modèles mondiaux compilés par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) – qui servent de référence dans le cadre de l’accord de Paris pour suivre les progrès réalisés – sont construits pour les terres. Ce manque de comparabilité des données s’appuie sur des études antérieures montrant que les progrès nets pourraient être surestimés de 18 % en conséquence.
Les universitaires affirment qu’il est essentiel de concilier ces divergences, car l’agriculture est actuellement le seul secteur capable d’éliminer le carbone à grande échelle de l’atmosphère, une condition nécessaire pour atteindre la neutralité carbone et stabiliser les températures mondiales. Le premier GST a mis en évidence les objectifs à atteindre d’ici 2030 pour que la planète reste en bonne voie pour atteindre les objectifs de température de l’accord de Paris (1,5 et 2 degrés Celsius). Il devrait être réexaminé et élargi dans le cadre des négociations climatiques de l’ONU, la COP30, qui se tiendront au Brésil plus tard cette année. Les gouvernements doivent désormais soumettre d’ici septembre prochain une nouvelle série de CDN plus ambitieuses, basées sur le GST. Cette nouvelle analyse soulève de nouvelles inquiétudes à l’approche des négociations climatiques, car les nouveaux plans ne prévoient pas les mesures nécessaires pour réduire les émissions mondiales.
Le fardeau des incendies et sécheresses
Giacomo Grassi, membre du bureau du groupe de travail du GIEC sur les inventaires de GES, a déclaré : « Il existe un décalage dans la définition de ce qui constitue un puits de carbone forestier anthropique, c’est-à-dire le puits qui peut être pris en compte pour atteindre les objectifs climatiques des pays. Cela a des conséquences cruciales sur notre capacité à évaluer les progrès climatiques mondiaux conformément à l’accord de Paris. Si nous n’évaluons pas avec précision où nous en sommes, nous ne pouvons pas corriger avec précision notre trajectoire vers le zéro net ». Les données analysées dans l’étude montrent que les gouvernements du monde entier signalent une légère augmentation du puits de carbone net à l’échelle mondiale. Parallèlement, les impacts climatiques tels que les incendies et les sécheresses mettent en péril la capacité des terres à absorber le carbone. L’étude révèle pour la première fois qu’environ deux tiers des engagements terrestres pour 2030 proviennent de réductions d’émissions, principalement grâce à la diminution de la déforestation, tandis qu’un tiers provient de la création de nouveaux puits terrestres grâce à la plantation d’arbres et à la restauration des forêts.

« Les pays du Sud gèrent la plupart des forêts et des puits de carbone de la planète, mais on attend d’eux qu’ils assument la stabilité climatique mondiale sans bénéficier d’un financement équitable », commente Dr Rebekah Shirley, directeur adjoint pour l’Afrique au World Resources Institute. « Pour mettre en place des voies économiques solides, vertes et résilientes, il faut disposer d’une marge de manœuvre budgétaire permettant d’investir dans un développement fondé sur la nature, de cadres d’endettement qui reflètent les risques climatiques et les avantages de la nature dans l’allocation des ressources, et de solutions à grande échelle qui contribuent à récompenser la bonne gestion », suggère-t-elle avant d’ajouter que : « La mise en œuvre prévue de la Facilité de financement pour les forêts tropicales lors de la COP30 offre une occasion historique de placer la nature, la biodiversité et la résilience au cœur de l’agenda climatique mondial». L’étude souligne que dans la deuxième soumission des engagements des pays (NDC 2020), les terres restent un secteur mondial très important pour l’atténuation, puisqu’elles représentent un quart des engagements mondiaux. Sans le rôle actif des puits terrestres mondiaux dans la stabilisation de l’augmentation des émissions des autres secteurs, les objectifs de l’accord de Paris ne peuvent tout simplement pas être atteints.
L’espoir de la COP 30
Les scénarios modélisés reposent sur de grandes quantités de puits supplémentaires pour maintenir l’objectif de 2 °C. « Alors que nous réduisons les émissions dans d’autres secteurs, il est essentiel de garantir un soutien suffisant et de promouvoir des modes de consommation durables afin de lutter contre la déforestation et d’améliorer les puits de carbone terrestres mondiaux. Dans le même temps, le maintien des puits de carbone terrestres actuels et supplémentaires deviendra plus difficile dans un contexte de détérioration des conditions climatiques, ce qui met en évidence le risque d’une dépendance excessive à l’égard des puits de carbone terrestres pour progresser en matière d’atténuation », affirme Rosa M. Roman-Cuesta, auteure principale de cette étude. Selon l’analyse, les 25 % de réduction des émissions provenant des terres dans les CDN ont peu de chances d’être atteints sans un soutien financier et institutionnel. Les auteurs soulignent que les options financières actuelles, essentielles pour soutenir les efforts mondiaux d’atténuation, sont sous-financées depuis des décennies. Cela inclut les activités destinées à financer les forêts, telles que les mécanismes REDD+. Même avec un financement approprié, les engagements liés aux terres d’ici 2030 devront rivaliser avec d’autres programmes de développement foncier, tels que l’expansion des produits agricoles, les opérations pétrolières et l’exploitation minière.
Les scientifiques affirment que la conversion des données entre les communautés qui estiment les émissions et les absorptions de carbone liées aux terres est nécessaire pour combler les lacunes actuelles. Ils suggèrent que les futurs bilans mondiaux devraient intégrer les données des pays sur les terres et améliorer le suivi et la communication d’informations. Il devrait également y avoir une comparabilité entre les modèles du GIEC et les engagements des CDN. Si les terres et les forêts doivent être intégrées dans les engagements d’atténuation à l’échelle de l’économie, les engagements liés aux terres devraient être séparés des autres efforts d’atténuation afin de mieux comprendre leurs moteurs et leurs menaces. De nouvelles solutions financières émergentes, telles que le Tropical Forest Forever Facility, devraient être lancées lors du Sommet des Nations unies sur le climat, COP30, qui se tiendra au Brésil plus tard cette année. Ce fonds vise à encourager financièrement la préservation des forêts.
Nadège Christelle BOWA